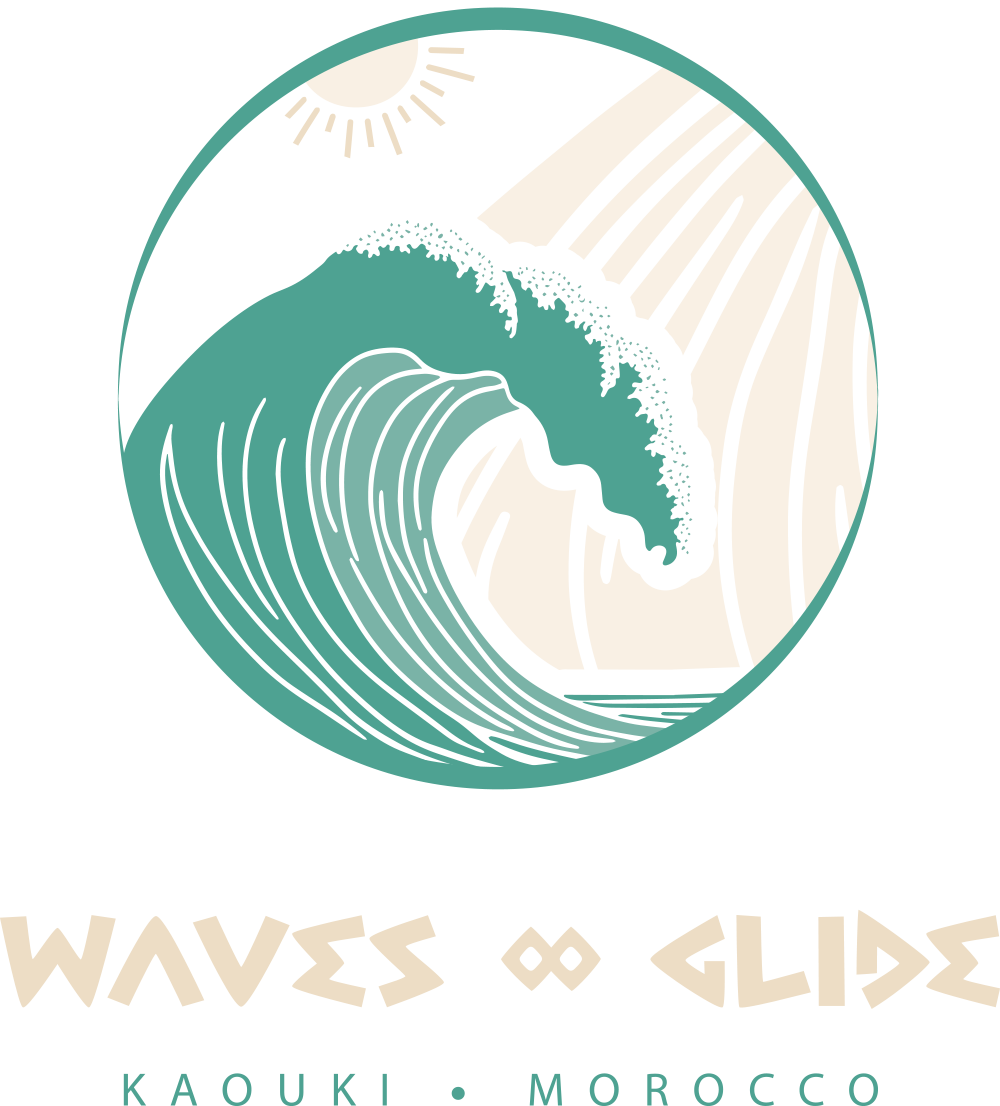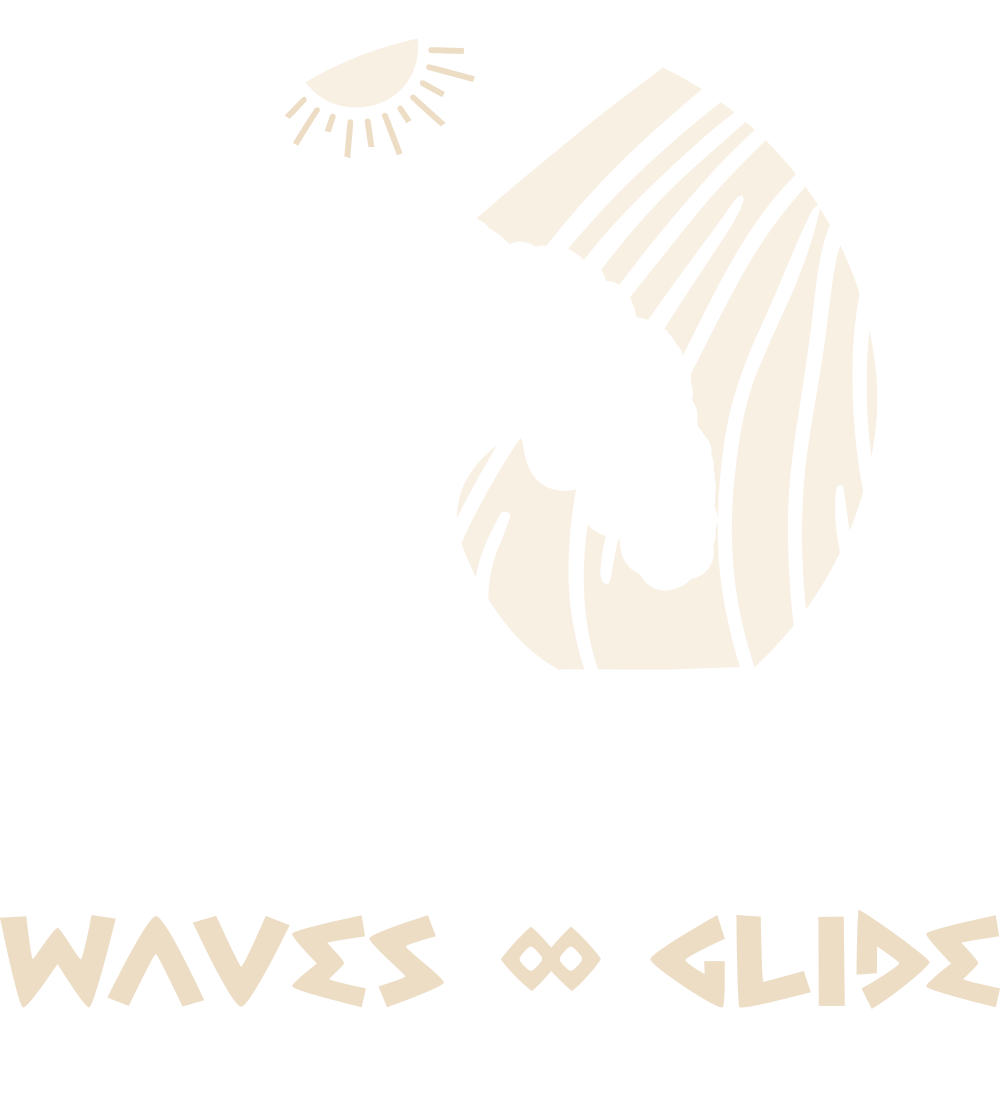Si on suit à la lettre et dans l’esprit, la définition du mot “surf”, prendre des cours de surf signifierait le fait d’apprendre à chevaucher les « houles déferlantes », C’est ce que font universellement les mammifères marins, certains oiseaux et poissons, et tous les pêcheurs artisanaux des régions côtières du monde qui doivent aller chercher le poisson au large de la zone des vagues. Le « Surf » est donc universellement un rapport aux vagues et à l’Océan, pour se déplacer, chercher sa subsistance, la fraicheur ou tout simplement pour y jouer, et se vivifier.
Dans la pratique ancestrale du “surf” – « Hee’enalu » en dialecte hawaïen- pratiquée de ce que l’on en sait en Polynésie , à Hawaï, au Pérou et en Afrique australe ; chevaucher les vagues à l’aide d’une planche en bois basique ou de son corps ne s’apprenait pas dans les écoles de surf mais par la simple fait de vivre le mode de vie traditionnel d’une société intimement liée à l’océan, ses vagues, ressources et itinéraires de déplacement.
Toute la population nageait, pêchait et glissait sur les vagues dans le partage et la célébration de la Vie et de la nature, en hommage au Divin ; et ce dès le plus jeune âge; les enfants apprenaient à jouer dans les vagues du bord avant même de savoir marcher…
L’arrivée de la civilisation mercantile avec les premiers explorateurs européens de l’ère chrétienne , bouleversa le mode de vie millénaire des hawaïens et polynésiens et la place de leur relation à l’océan et ses vagues, eux qui étaient, avant cela, aussi à l’aise dans l’océan, l’eau et les vagues que des mammifères marins , l’histoire relégua le “hee’nalu” à la dimension d’une pratique folklorique petit à petit oubliée, jusqu’’au début du 20 éme siecle où, elle enfanta le « Surf » dans sa version moderne grâce à l’évolution des structures économiques et sociales qui l’ont permis : les congés payés, les moyens de locomotion grand public, le tourisme ,la publicité, l’aménagement immobilier du littoral, les stations balnéaires et les nouvelles Olympiades .
A partir de là, entre Hawaii, la Californie et l’Australie, le surf se développa en tant que pratique sportive et mode de vie aquatique et naturel, désinvolte et marginal ; la créativité des surfeurs et la course des outils de production et de vente vers la performance , amena le surf à devenir accessible à tous , à s’institutionnaliser et s’universaliser.
Des premières exhibitions du légendaire Duke Kahanamoku en 1900 jusqu’à sa popularisation dans les « seventies » , et son explosion « numérique » de 2000 à nos jours, autant à Hawai que sur tous les archipels et villes côtières du monde, en passant par les grands lacs, fleuves et piscines à vague.
Il est prodigieux de constater le caractère aujourd’hui universel du surf et de certaines pratiques autrefois tribales et ésotériques de célébration de la vie et de la Nature, et de voir comme leurs bienfaits traversent les époques et les cultures.
Nous entendons aujourd’hui à l’époque du stress et du mal-être toutes les personnes qui surfent dire : « le surf m’a guérit et remis sur les rails » ; « le surf est mon antidépresseur » ou quelque chose de similaire, il est indéniable que surfer régulièrement avec une bonne hygiène de vie est une thérapie efficace contre le mal être et même contre certaines maladies dites « fatales ».